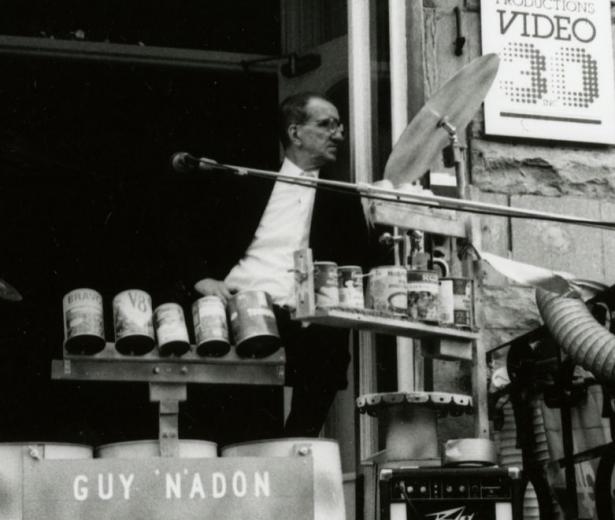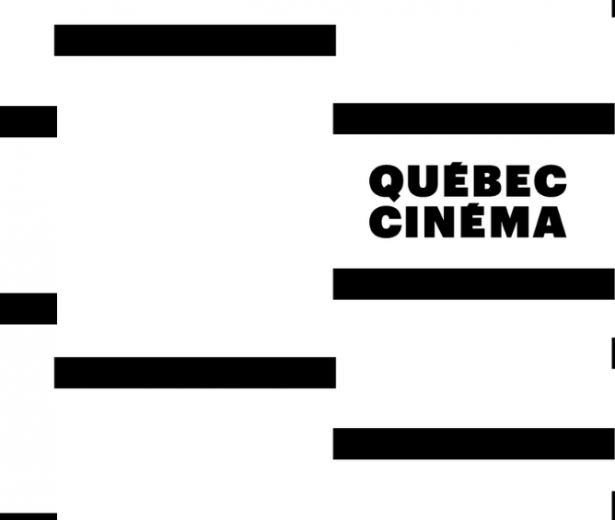Vendredi, 18 mars 2022
La scénariste et réalisatrice Sarah Fortin présente à compter de cette semaine son premier long métrage de fiction Nouveau-Québec (voir les horaires en salle). Tourné entièrement dans la région de Schefferville, le film relate l’histoire d’une montréalaise (Christine Beaulieu), qui part avec son petit ami (Jean-Sébastien Courchesne) dans cette région éloignée pour exaucer le souhait de son père défunt, un ancien mineur.
En premier lieu, parlez-nous de votre rapport avec Schefferville, une région que vous connaissez bien et qui vous est très chère.
Pour moi, il était indispensable que le film montre ce lieu-là. J’ai été à Schefferville pour la première fois en 2008 pour le projet Wapikoni Mobile. Je ne connaisais pas grand-chose de cet endroit, en dehors du fait qu’il y avait eu des mines et qu’il se dégageait du lieu une aura de ville-fantôme. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte qu’il restait des gens qui vivaient là et qui avaient toujours vécu là, peu importe si les mines avaient fermé leurs portes. Les membres des deux communautés autochtones étaient toujours restés là, sur les cendres des sites qui avaient été laissés à l’abandon. Cet aspect m’avait beaucoup intéressé. Ce lieu isolé, pourtant encore au Québec, situé au bout d’une route de douze heures de train, cela m’avait renversé.
Cet éloignement vous a saisi, et vous en avez fait le moteur, le coeur de votre récit.
Oui, tout à fait! On a tendance à vouloir s’éloigner beaucoup pour se sentir dépaysé, mais je trouvais hallucinant d’être plongée dans un univers tout aussi dépaysant que si l’on était à l’autre bout du monde. J’ai donc souhaité intégrer la notion de l’éloignement et de la perte de repères dans la vie d’un couple, et de voir quelle pression cela pouvait induire sur leur vie, quitte à faire émerger des choses qu’ils ne soupçonnent pas d’eux-mêmes.
Ce qui déstabilise encore plus le personnage incarné par Christine Beaulieu c’est sa rencontre avec une culture dont elle n’a aucune connaissance.
Ça aussi c’était important à aborder. À Schefferville comme dans d’autres endroits, les populations allochtones ont eu des contacts avec les autochtones. Pendant longtemps, on a eu un rapport très étrange avec eux. Un peu comme si nous les avions abandonnés dans un site où il n’y a presque plus de ressources ni travail, avant de s’en retourner sans s’en préoccuper. Comme si ils étaient de moindre importance. C’était donc important pour moi d’aborder le rapport à l’abandon, à l’impact de ce que l’on a laissé derrière nous. De quelle façon peut-on établir une nouvelle rencontre, plus sincère, plus dÉgal à égal.
De quoi vivent aujourd’hui les communautés de Schefferville?
La communauté de Matimekush-Lac John a un rapport au territoire très réel. Il y a cependant encore des enjeux sociaux et économiques. Les activités traditionnelles font encore partie de leur vie, mais de manière plus contemporaine. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent pour les minières qui ont recommencé leur exploitation. D’ailleurs, lorsque les compagnies ont repris leurs activités, il y a eu une crainte de voir se reproduire ce qui s’était passé quarante ans auparavant. On a exploité leur territoire et on a quitté en laissant des trous béants qui ont juste servi à détruire leur territoire…
Concernant votre scénario, comment vous-êtes vous assuré de la justesse de sa représentation? Avez-vous eu le support des communautés dans le processus d’écriture?
J’ai consulté énormément de gens, oui. Lorsque j’y suis allée en 2008, j’ai eu un coup de coeur très particulier pour cette région. J’y suis retourné à chaque année, en dehors de la première année de la pandémie. Je m’y suis fait des amis très chers qui m’ont accompagné tout au long du projet et à qui j’ai fait relire des versions successives du scénario. Avec le temps, j’ai tenté de me faire accepter et de faire accepter le projet. J’ai donc beaucoup travaillé avec eux. Dans cette communauté en particulier, mais aussi chez d’autres innus de la Côte Nord.
La rencontre que je créée dans le film entre les allochtones et les autochtones, je la souhaitais aussi dans l’expérience du tournage.
Il était important de trouver des acteurs issus de la communauté. Est-ce que le processus de casting a été difficile?
Oui, parce qu’il n’y a pas beaucoup d’expérience disponible, et parce qu’il faut que les gens aient envie de vous suivre dans votre projet. Parfois, il y a de la gêne, parfois il y a une forme de désintérêt, mais parfois aussi il y a des enjeux de confiance en soi qui impliquent un sentiment d’incapacité à jouer dans un film. Il faut respecter ça aussi. Oui, c’était un défi, mais c’était important pour moi que l’on voit les gens qui vivent là, qui connaissent le lieu, parce que c’est en partie leur histoire que l’on raconte. Le récit est purement fictif, mais c’est une collection de plein de choses racontées ou vécues, donc les gens peuvent se reconnaitre dans certains aspects du film. Il fallait aller chercher cette sensibilité-là. En même temps, j’ai senti que le projet générait beaucoup d’attention et d’intérêt. Une particularité intéressante du projet est que Sylvio Arriola avait un double emploi dans la production. On l’avait casté pour qu’il joue son personnage (le rôle du policier, NDLR), mais aussi pour qu’il puisse faire de l’accompagnement au jeu avec les acteurs, vu que nous ne pouvions pas être sur place un mois avant le tournage pour faire des répétitions avec les comédiens. Nous n’avions pas ces moyens-là malheureusement. Donc, pendant que j’étais sur le plateau, Sylvio faisait les répétitions avec les acteurs non professionnels pour pouvoir mieux les préparer, mais aussi pour leur donner les bases de la structure de tournage d’un film. Son apport a été exceptionnel.
Avec le budget modeste dont vous disposiez et la nécessité de déplacer une équipe aussi loin, quels ont été vos principaux défis de production?
On en a eu… mais, et c’est une théorie toute personnelle, on dirait qu’il y a deux façons de faire des films éloignés. Soit on n’a aucun budget, et on y va avec de l’huile de bras et tout le monde y met du sien, soit on a énormément de budget. Entre les deux, c’est plus difficile. Mais c’est vrai que les contraintes de déplacement et les coûts qui y sont reliés ajoutent beaucoup de défis. Dans notre cas, on s’est arrangé pour avoir une équipe dédiée, qui savait dans quoi on s’embarquait. On savait qu’on allait partir un mois et demi, deux mois, complètement isolés dans la communauté. Bien sûr, cela limitait les possibilités. Par exemple on savait que l’on ne pouvait pas faire venir les acteurs par avion, pour une journée de tournage. Donc on a dû se concentrer sur les rôles importants que l’on pouvait faire venir de l’extérieur, en dehors bien sûr des rôles principaux qui ont été avec nous pour toute la durée du séjour. Il nous a fallu trouver pas mal de petits trucs pour contourner nos enjeux financiers. On était une petite équipe d’une vingtaine de personnes. L’équipe caméra… au maximum de son talent, mais au minimum de ses capacités! Une personne par poste. L’assistant de prod qui donnait parfois un coup de main à l’éclairage… On a choisi aussi de ne pas avoir de coiffeuse-maquilleuse, par soucis de vérité, de naturel. C’était une concession qui me séduisait. Tout le monde a embarqué dans cette aventure à pieds joints. Je crois que c’est l’effort de groupe qui a fait que nous avons réussi à trouver des solutions à nos soucis. Il fallait être autonome et savoir se débrouiller par nous-mêmes. Tout cela a contribué à créer un sentiment de participer à une collectivité, une équipe qui vit ensemble, qui travaille ensemble et qui se découvre. La rencontre que je créée dans le film entre les allochtones et les autochtones, je la souhaitais aussi dans l’expérience du tournage. Pour moi, c’était merveilleux. On avait l’impression de faire partie de la vie communautaire. Il y a de vrais liens, de vraies relations qui se sont tissés là-bas. C’est ma plus grande fierté dans tout ça.
Entrevue réalisée le 7 mars 2022, par téléphone