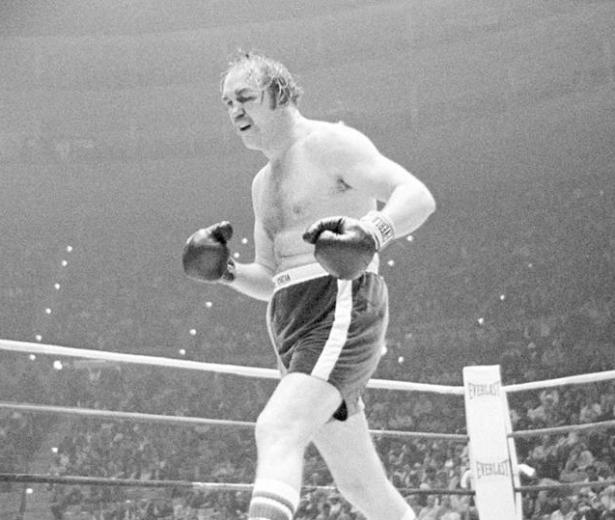Vendredi, 5 mars 2021
À l’occasion de la sortie en salle de Mon année Salinger, nous nous sommes entretenus avec l’auteur et réalisateur Philippe Falardeau, qui signe ici son huitième long métrage de fiction en carrière.
Mettant en vedette les actrices américaines Sigourney Weaver et Margaret Qualley, le film suit le parcours de Joanna, embauchée comme assistante d’une agente littéraire très stricte qui a pour client le grand écrivain J.D. Salinger. Grâce à ses échanges épistolaires avec l’auteur de L'attrape-cœurs et à la lecture du courrier de ses admirateurs, Joanna va progressivement trouver sa voie.
Tourné à Montréal et à New York, Mon année Salinger est une chronique intimiste inspirante, destinée à un public de tous âges. Distribué par Métropole Distribution, le film prend l’affiche aujourd’hui, le 5 mars, en salle et en VSD, en version française et en version originale anglaise avec sous-titres.
Ce qui se remarque de prime abord, c'est l'approche féminine du film, ce qui est une première pour vous. Est-ce le livre qui vous a orienté dans cette voie, ou est-ce qu'après The Bleeder vous teniez à faire une histoire racontée du point de vue d'une femme?
Je suis content que cela se remarque lorsque l’on regarde le film. Oui, il y a certainement une approche féminine, et à quelque part féministe dans le film. Je ne sais pas si c’est du à The Bleeder, mais ce film a certainement cristallisé mon désir de changer de paradigme, qui existait depuis mon premier long métrage. Tous mes films étaient des histoires de personnages essentiellement masculins. C’était une manière de renouveler mon regard sur les choses. J’arrivais souvent avec des personnages féminins très intéressants, mais qui ne portaient pas le film sur leurs épaules. J’auditionnais ou j’embauchais des actrices formidables, qui se retrouvaient souvent avec des rôles décevants. Suzanne Clément a joué des rôles de soutien, alors que c’est une actrice que j’adore, dans The Bleeder justement, j’avais des actrices assez formidables : Elizabeth Moss, Naomi Watts, Reese Witherspoon dans The Good Lie avaient toutes un rôle secondaire. Quand j’ai lu le livre, j’ai vu qu’il m’offrait l’opportunité de changer ça. J’ai aussi été beaucoup touché par l’histoire et j’avais vraiment envie de faire un film autour de ça, mais je n’aurais pas été capable d’écrire un scénario à partir de zéro, c'est-à-dire uniquement basé sur mon imaginaire.
Le film est basé sur le roman autobiographique de Joanna Rakoff. Quelle a été la genèse de l'écriture et comment l'autrice - qui est également productrice exécutive - a-t-elle été impliquée.
Elle a été impliquée au sens où je lui ai demandé de m’accompagner, d’être ma première lectrice, ma consultante à la scénarisation. Travail que, au demeurant, je fais pour d’autres personnes. L’idée c’est d’avoir un regard extérieur. Et en plus, c’était sa vie dont il était question. Je voulais m’assurer de ne pas trahir ce qui s’était passé. Je savais qu’il fallait inventer des scènes, en fiction on n’a pas le choix, on ne peut pas recopier tout ce qui est dans le livre. Cela ne se fait pas comme ça. Il faut savoir inventer des scènes qui représentent l’esprit du livre. Et je savais aussi que j’avais Joanna avec moi pour m’encourager à aller dans cette direction. D’ailleurs, fait assez étonnant qui m’a marqué, c’est quand j’étais allé à Boston pour une journée de travail avec elle. J’étais déjà à la deuxième ou troisième version du scénario, et elle m’a dit "j’aime beaucoup les scènes qui ne sont pas dans le livre. Je pense que tu devrais aller plus loin dans ce sens". Cela m’a beaucoup libéré, car je savais qu’elle était là pour cautionner ce que j’inventais.
Il s'agit d'un récit d'émancipation, mais par le biais duquel vous rendez hommage à la littérature, au livre, et plus généralement à l'écrit. Vous montrez surtout l'importance que cela peut avoir dans la vie des lecteurs. Est-ce que ces personnages extérieurs faisaient partie du roman original?
Oui, au sens où Joanna racontait le contenu des lettres. Donc, c’est inspiré de lettres adressées à Salinger qui l’avaient touchée. J’ai pris ça et j’ai inventé des personnages, comme des fantômes, des fantasmes. On est davantage dans la tête de Joanna, sauf lorsque l’une d’entre elles surgit au bureau, mécontente que Joanna ait pris les choses en main. Ces personnages, ce sont comme des graines que la vraie Joanna a semé dans son livre et que j’ai fait pousser pour en faire quelque chose de cinématographique.
Je pense que ce qui est intéressant dans le personnage de Joanna, c’est que c’est une ambitieuse silencieuse, contrairement à son chum qui lui dit ‘I’m writing a novel’. Elle, elle n’a pas le courage de dire comme ça à un inconnu qu’elle écrit de la poésie. Mais c’est ça qu’elle veut faire. L’ambition est une bonne chose. Pendant trop longtemps, on n’a pas encouragé les femmes autant que les hommes à verbaliser leurs ambitions. My Salinger Year c’est aussi un film sur l’ambition féminine. C’est également incarné dans le personnage de la patronne, qui représente les icônes féministes des années 1960 et 1970. Quand on pense au chemin que prenaient les gars et les filles. Un gars qui veut devenir un auteur s’assoie dans un café toute la journée, vit un peu la vie de bohème, boit des bières et fume des cigarettes, écrit un peu… La fille, elle, elle doit se trouver une job comme secrétaire… c’est quand même deux poids deux mesures. Je pense que les choses ont changé et continuent de changer… Le film parle beaucoup de ça aussi.
Parlant de personnages, j'aimerais que vous me disiez comment vous avez façonné celui de Margaret, qui à priori peut sembler rébarbatif. Comment s'est passée votre collaboration avec Sigourney Weaver?
Le personnage de la patronne est très drôle dans le livre. Elle est pleine d’idiosyncrasie, de travers qui nous font sourire, mais elle reste linéaire. Et je savais que si je voulais développer cette idée du mentor, elle devait avoir sa propre courbe dramatique, même si elle était subtile. Et ça c’était bien avant de savoir qui allait incarner le rôle. Et donc, j’ai inventé des scènes, par exemple, lorsque Joanna va chez Margaret. Ce n’était pas dans le livre, mais cela reflétait l’empathie de la vraie Joanna et de son refus de toujours obéir au protocole…
… Et qui dévoile la personnalité finalement très émouvante de la patronne…
C’est ça. Cela nous permet d’aller dans une tragédie. Quand Sigourney a lu le scénario, cela lui a plu, même si on savait qu’on devrait construire quelqu’un de froid et distant au début Il y a même des idées qui sont venues d’elle, par exemple le fait de ne pas du tout porter de maquillage pour tourner la scène où l’on va chez elle. Pour la montrer dans toute sa fragilité. Le matin sur le plateau, elle me dit "es-tu content de mon maquillage?", en voulant parler de son absence de maquillage. Curieusement… je la filmais et je me disais qu’elle n’avait jamais eu l’air aussi jeune dans le film que pendant ces scènes tournées sans maquillage. Parce que les masques, oui, cela rajeunit, mais en même temps, cela indique que la personne derrière le masque, elle a pris de l’âge, alors que là je trouvais qu’elle était formidable! Et cela correspondait exactement à ce que l’on voulait faire avec son personnage, c’est d’en arriver à un coup de chute, où c’est elle qui au final est vulnérable. Ce qui est intéressant quand on écrit, c’est que le scénario nourrit le personnage, mais aussi, les actrices me permettent de retourner à la table de travail et de faire des ajustements parce qu’elles m’ont donné encore plus que ce que le scénario offrait.
Et tout cela a aussi dû être ajusté en cours de tournage?
Des fois j’improvisais des images, surtout avec Margaret Qualley qui est une fille très visuelle. Son jeu est très physique. Elle a un corps, un regard et un visage très expressifs. Je m’amusais avec elle parfois à improviser de courts moments non dialogués. Par exemple, lorsqu’elle est en face de sa machine à écrire et qu’elle ferme les yeux pour mieux écouter le ronronnement de la machine. C’est juste avant une scène. Elle a immédiatement compris pourquoi son personnage ferait ça. Et c’est devenu une photo qui circule beaucoup en ce moment sur internet. Tout ça, c’est dû au travail qui se fait dans les interstices du scénario sur le plateau. Aussi, en amont du tournage, j’avais donné une copie du livre à Margaret Qualley, en lui disant de détecter des choses qui la touchaient, mais que, pour des raisons XYZ, j’avais laissées de côté. On a eu une longue discussion ensuite, ce qui m’a permis de ramener certaines choses et d’en laisser tomber d’autres, tout en m’assurant que ma comédienne serait davantage stimulée, impliquée, interpellée par le scénario.
En terme de mise en scène et d'esthétique, quels ont été les défis à surmonter pour recréer à Montréal le New York des années 1990? Comment avez-vous travaillé avec la direction photo et la direction artistique?
Les années 1990, ça ne faisait pas pantoute mon affaire! Parce que ça coûte cher et qu’on n’est pas dans les années 1950 ou 1970 qui amènent leur lot de nostalgie, mais où les choses sont tellement tranchées qu’on est tout de suite transporté ailleurs. Les années 1990, c’est un entre-deux où tout est différent, mais pas tant que ça. Donc, tout était à changer, mais rien n’est réellement payant à l’image, sauf peut-être certains costumes grunge ou l’absence de téléphones cellulaires. Mais, cela complique la vie pour rien. J’ai déjà fait les années 1960. C’est clair. Avec Chuck (The Bleeder, NDLR), j’ai fait les années 1970. Les années 1970, c’est sale, c’est sexy, ça pue la drogue… c’est payant à l’image! Les années 1990, je pense que ça sera payant dans vingt ans. Par contre, je n’avais pas le choix à cause de Salinger. Je ne pouvais pas transposer le récit à une autre époque.
Vous aviez commencé le tournage il y a bientôt deux ans. Le film sort finalement ici et bientôt aux États-Unis, plus d’un an après sa première présentation. Je suppose que vous devez être soulagé?
Oui! Au milieu de la pandémie, j’avais envie que le film sorte en VSD. Les gens avaient envie de voir des films… Là j’ai un peu le meilleur des deux mondes, au Québec en tout cas, puisque dans le reste du Canada les salles sont fermées. Aux États-Unis, on a réussi à dénicher environ 120 salles, ce qui est un miracle. Je suis content, peu importe ce qui adviendra avec les chiffres. Il ne faut pas mesurer le box office comme on le mesure normalement. Il faut juste se dire que le film est disponible, qu’il va circuler et qu’il va être vu. Après, il faut essayer de se démarquer dans un océan de créations cinématographiques et de séries télé. On compétitionne contre tout ça maintenant. Mais moi, je ne vois plus les sorties de films comme il y a quinze ans. The Good Lie, qui est peut-être mon film le moins réussi, en ce qui me concerne, est celui qui est actuellement le plus vu et revu. Les gens continuent de le voir, les gens continuent de m’écrire à son sujet. Et c’est ce qui est génial avec les plateformes! Je me réjouis à l’idée que My Salinger Year va avoir un pic maintenant, et que dans les années à venir, quand la musique des années 1990 va redevenir à la mode, les gens vont peut-être vouloir le revoir.
(Image d’en-tête : Philippe Falardeau – Crédit L. Guerin)